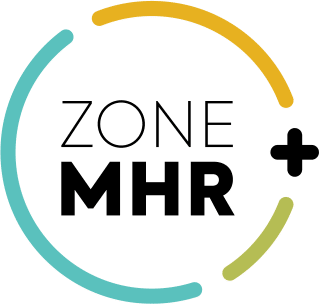Quand l’œil anglais capture le charme pittoresque de Saint-Jean au tournant du siècle
Vers l’année 1900, le photographe Norman Macmillan Hinshelwood (1873-1904) était de passage dans notre région. Né à Salford dans le nord de l’Angleterre, Hinshelwood venait à peine de débarquer au Canada, qu’il s’établissait à Montréal. C’était en 1897¹.
Celui qui travaillait comme expert-comptable dans la métropole, tout en exploitant une entreprise d’édition, s’adonnait parallèlement à la pratique photographique, un domaine dans lequel il excellait².
Emporté dans la fleur de l’âge, par une foudroyante pneumonie en mars 1904, N. M. Hinshelwood, trente et un ans, laissera derrière lui une importante collection de photographies ainsi que des ouvrages dont l’intérêt historique fut jugé considérable par ses contemporains³.
À cet effet, dans les pages de son volume intitulé Montreal and Vicinity (1903)⁴, Hinshelwood présente différents clichés de ce qui deviendra Saint-Jean-sur-Richelieu. L’auteur s’attarde aux environs pittoresques de la rivière Richelieu qu’il capture au moment de promenades qui lui ont semblées « jolies et intéressantes ».
Retour en images sur les deux rives du Richelieu, sur les agglomérations de Saint-Jean et d’Iberville du tournant du XXème siècle, à travers l’œil du photographe Norman Macmillan Hinshelwood.

Norman Macmillan Hinshelwood, Canal à Saint-Jean, QC, vers 1900, Négatif à la gélatine argentique sur verre, Collection McCord.
Saint-Jean
Toujours dans son ouvrage Montreal and Vicinity, Hinshelwood note l’importance appréciable de Saint-Jean qui est alors un chef-lieu de comté⁵. L’auteur précise que l’on dénombre plus de 5000 habitants dans cette ville qui est traversée par pas moins de cinq lignes de chemin de fer : le Grand Tronc, le Canadien Pacifique, le Rutland, le Central Vermont ainsi que le Delaware and Hudson.⁶
En outre, Saint-Jean abrite à l’époque de nombreuses industries. Au passage, Hinshelwood mentionne d’ailleurs la Corticelli Silk Company, mais s’intéresse également aux différentes fabriques de poteries, qui seraient selon ses dires les seules du genre au pays.⁷
Le photographe poursuit sa description en brossant le portrait d’un Saint-Jean qu’il qualifie de bien aménagé, avec ses nombreux hôtels, ses magasins de premier ordre, ses grandes casernes ainsi que son école militaire⁸.
Norman Macmillan Hinshelwood pointe par ailleurs quelques édifices qui lui semblent dignes de mention : un ancien temple protestant (St. James Church), l’église catholique (aujourd’hui la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste), le couvent tenu par les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame (désormais disparu) ainsi que l’hôpital dirigé par les Sœurs grises (l’actuel Centre Georges-Phaneuf)⁹.
Canal de Chambly
Dans un cliché intitulé Canal à Saint-Jean, on reconnaît les abords de l’écluse numéro neuf du canal de Chambly, située près de l’intersection des actuelles rues Saint-Paul et Champlain. Regardez les tombereaux des charretiers captés par le photographe anglais ainsi que l’embarcation au premier plan décorée de motifs ondoyants et dont le mât vient créer une diagonale dans l’image.
En 1822, Saint-Jean était d’ailleurs le quatrième port en importance au Canada. La rivière Richelieu constituait alors la principale voie navigable pour se rendre aux États-Unis, mais elle comptait cependant une série de rapides qui venaient grandement compliquer la navigation¹⁰.
Il faudra toutefois attendre le printemps 1843 pour que le canal de Chambly, jalonné par neuf écluses en pierres de taille et s’étendant sur une distance de 17 km, s’ouvre enfin à la navigation.

Norman Macmillan Hinshelwood, Canal à Saint-Jean, QC, vers 1900, Négatif à la gélatine argentique sur verre, Collection McCord.
Chemin de halage
Bien que largement empruntés par des voiliers et des cages (caravanes fluviales manœuvrées par des cageux), l’étroit canal sera toutefois et contre toute attente en partie désuet dès son inauguration en 1843, la plupart des bateaux à vapeur ne pouvant s’y aventurer en raison de leur dimension.
Pour pallier cette fâcheuse situation, les vaisseaux étaient dans l’obligation de cesser leur progression entre Saint-Jean et Chambly. À cet endroit, ils étaient donc relayés par de petits bateaux à fond plat (barges) qui devaient franchir le chenal, halés par des chevaux et ce jusqu’en 1940, moment où le travail de l’animal fut totalement suppléé par celui de l’automobile ou du tracteur qu’on utilisait d’ailleurs depuis 1909¹¹.
Dans cette seconde photographie signée Hinshelwood et montrant le canal de Saint-Jean, on peut apercevoir des chevaux tirant une barge sur l’ancien chemin de halage, qui de nos jours est plutôt quotidiennement investi par des marcheurs et des cyclistes. Ce tronçon fluvial qui connut par ailleurs son apogée commerciale vers 1910, est désormais emprunté par les plaisanciers. Regardez ici la courbe décrite par le chemin de halage. Cette sinuosité mise en exergue par le cadrage de Hinshelwood dynamise le cliché et montre que de toute évidence son auteur avait un souci marqué pour la composition de ses images photographiques.

Norman Macmillan Hinshelwood, Pont, Saint-Jean, QC, vers 1900, Négatif à la gélatine argentique sur verre, Collection McCord.
Pont blanc
Poursuivant sa pérégrination sur le versant oriental de la rivière Richelieu, Norman Macmillan Hinshelwood s’attardera sur le vieux pont Jones¹². D’ailleurs, au moment d’immortaliser cette vue intitulée Pont, Saint-Jean, c’est précisément sur cette traverse que se tient le photographe anglais.
Il s’agit là de la première passerelle à enjamber durablement la rivière Richelieu entre Saint-Jean et Iberville. Réalisé par les frères Howe originaires d’Angleterre et établis au Massachusetts, ce pont fait de bois permettait le libre passage des vaisseaux et des cageux¹³.
Hinshelwood précise qu’un péage était exigé pour passer ce pont qui était la propriété de l’honorable Robert Jones¹⁴. Notons que la maison de péage est aussi bien visible dans cette photographie. Enfin, notons que c’est parce qu’il était recouvert de chaux, un enduit blanc et perméable ayant également la propriété de luire dans la nuit, que le fameux pont Jones sera surnommé le « pont blanc »¹⁵.

Norman Macmillan Hinshelwood, Vieille maison à Iberville, près de Saint-Jean, QC, vers 1900, Négatif à la gélatine argentique sur verre, Collection McCord.
Pittoresque
À travers les pages de Montreal and Vicinity, Hinshelwood nous entretient en outre de l’église Saint-Athanase et de son clocher qui apparaît d’ailleurs à l’artiste comme l’un des plus remarquables du pays. Sur une note amusée, Hinshelwood s’interroge toutefois si l’architecte a ici tenté de concevoir un clocher d’église ou plutôt une pagode chinoise¹⁶.
En 1895, lorsque Casimir Saint-Jean revisite la flèche de ce temple, il lui confère en effet une esthétique des plus audacieuses et semble-t-il inspirée d’une église européenne fort originale. Cet ouvrage d’architecture disparaîtra cependant en fumée dans la nuit du 6 février 1912¹⁷.
Puis, en suivant la route qui longe le Richelieu, Hinshelwood traversera ensuite ce qu’il décrit comme un charmant petit vallon boisé, avant de s’aventurer dans les champs, là où il trouvera environ un demi-mille plus loin, les ruines d’un vieux moulin qui avait été partiellement détruit par un incendie, quelques années plus tôt : le moulin McGinnis¹⁸.
En relatant sa déambulation à travers un Iberville ombragé d’arbres immenses, Norman Macmillan Hinshelwood insiste surtout sur le caractère extrêmement pittoresque des lieux. Pittoresque apparaît en effet un terme prisé par l’auteur pour décrire notre région.
Notons que le mot « pittoresque », de l’italien pittoresco, signifie « capable d’être peint ». Ainsi, on dira d’un lieu ou d’un objet pittoresque qu’il est à la fois fascinant et agréable, ce qui donnerait envie à l’artiste de le représenter.
Cette brève traversée d’une époque révolue – offerte par Hinshelwood – agit comme un profond révélateur. En remontant ainsi le temps à travers l’œil de ce photographe anglais, nous sommes à même de constater les importantes transformations subies par notre ville, par ces lieux qui nous apparaissent aujourd’hui davantage façonnés par la perte, que par le pittoresque.
Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.
Références:
¹ Portail des archives d’Appartenance Mauricie – Fonds – Fonds Norman Macmillan Hinshelwood, [en ligne] http://atom.appartenancemauricie.ca/index.php/fonds-norman-macmillan-hinshelwood, [site consulté le 5 avril 2025.]
² « Mr. Hinshelwood dead », dans The Montreal herald, 11 mars 1904, no 60, p.5.
³ Ibid
⁴ N.M. Hinshelwood, Montreal and vicinity, being a history of the old town, a pictorial record of the modern city, its sports and pastimes, and an illustrated description of many charming summer resorts around, Desbarats and co., Montréal, 1903, 154 p. ill.
⁵ Ibid., p. 143.
⁶ Ibid
⁷ Ibid
⁸ Ibid., p. 144.
⁹ Ibid
¹⁰ 10 Marilou Desnoyers, Regard sur 350 ans d’histoire. Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2016, p. 127-128.
¹¹ Ibid
¹² Op.cit., Hinshelwood, p. 145
¹³ Op.cit., Desnoyers, p. 91.
¹⁴ Op.cit., Hinshelwood, p. 145.
¹⁵ Op.cit., Desnoyers, p.92.
¹⁶ Op.cit., Hinshelwood, p. 145.
¹⁷ Op.cit., Desnoyers, p. 130-131.
¹⁸ Op.cit., Hinshelwood, p. 145.
Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.