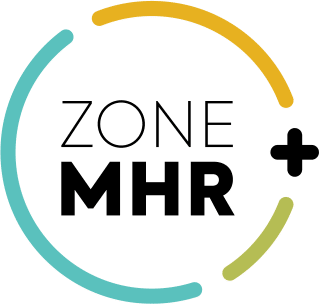La correspondance de Madame Bégon et le deuxième fort Saint-Jean
Alors que la guerre de succession d’Autriche (1740-1748) tire à sa fin, on ne peut envisager sans crainte la colonisation dans la région du lac Champlain, l’insécurité y étant toujours palpable.¹
Ce conflit européen qui opposait en plus de la France et de l’Angleterre différentes puissances, dont la Prusse, la Bavière, la Saxe et l’Espagne eut en effet des répercussions sur notre territoire, alors qu’il viendra se doubler d’un affrontement intercolonial, en se transposant notamment en Nouvelle-France avec la prise de la forteresse de Louisbourg par les Britanniques en 1745.²
Dans la foulée, le commandant général de la Nouvelle-France, Roland-Michel Barrin de La Galissonière, décide en 1747 de faire construire un nouveau fort Sainte-Thérèse. Mais au printemps 1748, de La Galissonière se ravise.
Dans l’optique de consolider la défense du territoire et de servir d’appui au poste davantage exposé de Saint-Frédéric (Crown Point, N.Y.), il choisit plutôt de démanteler la fortification de Sainte-Thérèse et d’en faire s’ériger une à Saint-Jean, sous la direction de l’enseigne et ingénieur militaire Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils).³
Différentes pièces d’archives nous permettent aujourd’hui de brosser un portrait de cette fortification disparue en fumée le 30 août 1760. C’est d’ailleurs par un hasard le plus complet, que l’une d’entre elle émergeait du passé, il y a près de 100 ans, soit la correspondance d’une certaine Madame Bégon.

Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry fils, Plan du fort [Saint-Jean] au-dessus du rapide St-Jean où mouïlle la barque du Lac Champlain, 9 juin 1748. FR CAOM, 3DFC503B Archives nationales d’outre-mer MFSJ17480609001 Collection Musée du Fort Saint-Jean
De Bonnault
En 1932, l’historien Claude de Bonnault, alors correspondant pour les Archives de la Province de Québec en France se rend chez la comtesse de Rancougne, une lointaine descendante de la famille Bégon. Sachant que de Bonnault s’intéresse à l’histoire du Canada, son hôte lui apporte une petite caisse remplie de différents papiers qui ne tarderont pas à faire le bonheur du chercheur. ⁴
Se trouvait là, enfouies, des lettres datant de près de deux siècles et qu’avait écrites Marie-Isabelle-Élisabeth Rocbert de la Morandière, la veuve de Claude-Michel Bégon de La Cour, ancien gouverneur de Trois-Rivières, à son gendre, le veuf Honoré Michel de Villebois de La Rouvillière.
Grâce à de Bonnault, cette correspondance rédigée vers la fin du Régime français par cette notable montréalaise et comprenant neuf cahiers ainsi que de trente-huit feuilles volantes s’échelonnant du 12 novembre 1748 au 12 avril 1753, sera finalement rapatriée au pays, pour être conservée dans les Archives nationale du Québec. ⁵
Élisabeth Rocbert
Née à Montréal le 27 juillet 1696, Marie-Isabelle-Élisabeth Rocbert, la fille aînée du garde-magasin du roi à Montréal, Étienne Rocbert, sieur de la Morandière et d’Élisabeth Du Verger, a tout juste 16 ans lorsqu’elle fait la rencontre de l’enseigne de vaisseau, Claude-Michel Bégon de La Cour. ⁶
Né à la Martinique le 15 mars 1683, Claude-Michel Bégon est pour sa part issu d’une noble et influente famille originaire de la région de Blois en France. Très tôt, le jeune Bégon épouse la carrière rude et non sans risque de marin, alors qu’il s’embarque dès l’âge de douze ans sur le croiseur Fougueux. ⁷
Portant les stigmates de la guerre, une bataille navale lui ayant ravi son œil droit en plus de lui laisser plusieurs doigts mutilés, Bégon débarque à Montréal en 1712. En l’absence de casernement pour héberger les militaires, il est reçu chez la famille du garde-magasin Rocbert. ⁸
Là, il ne tarde pas à s’éprendre de la jeune Marie-Isabelle-Élisabeth (plus souvent prénommée Élisabeth). Toutefois, les origines modestes de cette dernière constituent un obstacle de taille à leur union.
Gaumine
En effet, l’intendant de la Nouvelle-France, Michel Bégon de la Picardière, le frère aîné de Claude-Michel Bégon, a tôt fait de s’objecter à ce mariage, que l’on qualifie même à l’époque de mésalliance. Il s’y opposera d’ailleurs durant plusieurs années. ⁹
À cela s’ajoute l’impossibilité pour un militaire de quitter son célibat sans avoir d’abord obtenu l’aval du gouverneur, une autorisation servant à éviter les « mauvais » mariages, mais également à retenir les soldats au service le plus longtemps possible. ¹⁰
Ainsi, le gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil refuse d’octroyer sa permission à Claude-Michel Bégon. Cependant, il encourage en tapinois la forte inclination de l’officier afin, dit-on, de contrarier l’intendant Bégon avec qui il ne s’entend guère. ¹¹
Passionnés, entêtés, les deux amants choisissent néanmoins de défier toutes conventions et de s’unir dans le plus grand des secrets, « à la gaumine ». Cette pratique, vivement condamnée par l’Église, tient par ailleurs son nom d’un certain Michel Gaumin, qui avait réussi à contracter clandestinement mariage lors d’une messe, en éludant toute bénédiction officielle. ¹²
Madame Bégon

Henri Beau, Madame Bégon, huile sur toile, 1935. Bibliothèque et Archives Canada, No. 1989-518-2.
Elisabeth Bégon, que sa belle-famille appelait même « l’Iroquoise », ne sera cependant jamais totalement acceptée. De ce pseudo-mariage, qui sera au bout du compte régularisé le 19 décembre 1718, année où Claude-Michel Bégon est fait chevalier de Saint-Louis, naîtront cinq enfants. L’aînée, Marie-Catherine-Élisabeth liera sa destinée, le 17 novembre 1737, à Honoré Michel de Villebois de La Rouvillière, commissaire subdélégué de l’intendant à Montréal.
La fille des Bégon sera cependant fauchée par la tuberculose à vingt et un ans, laissant derrière elle deux jeunes enfants que sa mère Élisabeth dû élever. En 1743, Claude-Michel Bégon accède finalement au poste de gouverneur de Trois-Rivières. Puis, malade une partie de l’hiver de 1747-1748, le chevalier Bégon s’éteint le 30 avril 1748, lors d’un voyage à Montréal. ¹³
Brûlante passion
Désormais veuve, Élisabeth Bégon retourne vivre dans sa demeure mondaine de la rue Saint-Paul à Montréal, là où elle tient salon. Celle qui est proche du pouvoir grâce à ses nombreuses relations et amitiés, se fait dès lors la chroniqueuse de son époque et débute des écrits journaliers qu’elle adresse à « son cher fils », le veuf de Villebois, établit en Louisiane.
À noter que pour certains historiens qui s’attarderont à la correspondance de Madame Bégon, ces missives seraient l’aveu de la brûlante passion qu’entretenait la veuve envers son gendre d’à peine six ans son cadet
Pour d’autres, qui s’appuient notamment sur les codes de l’épistolarité privée de l’époque, il faut plutôt y déceler un témoignage d’affection familiale, amicale et rien de plus. Tous s’entendent cependant sur le fort intérêt à la fois historique et littéraire de ces rares écrits féminins et laïques hérités du Régime français.
Fort de pieux
Dans l’une de ses lettres datée du 12 décembre 1748, Madame Bégon discute du deuxième fort Saint-Jean de 1748, précisant à son gendre que « tous ceux qui ont vu cet ouvrage disent que cela est fort joli, mais cela est de bois et par conséquent peu solide ». ¹⁴
En effet, les ressources financières de la colonie étant restreintes, il avait été décidé que le nouveau fort Saint-Jean qui devait proposer un tracé de 200 pieds de côté et être munie de bastions aux quatre angles, serait de construction modeste et donc fait de bois.
En outre, Élisabeth Bégon viendra ajouter dans une autre missive datée du 22 février 1749, que « nos puissances » projettent une visite officielle à la fortification de Saint-Jean et que ce sujet est aujourd’hui sur toutes les lèvres.¹⁵
Au retour de sa campagne au fort Saint-Jean, le marquis de La Galissonière, neveu par alliances et fidèle ami de l’influente Madame Bégon, viendra la retrouver et lui confier qu’il ne trouve pas sans défaut ce nouvel ouvrage militaire. En relatant cet entretien à son beau-fils, l’épistolière décrit au passage « ce fort de pieux, dont seul le plain-pied était constitué de pierre et où il y aurait toujours des réparations à faire ».¹⁶
Occupant une place fondatrice dans l’histoire de la littérature au temps de la Nouvelle-France, il est heureux de trouver dans le journal épistolaire de Madame Bégon ces quelques perles qui nous transportent dans les coulisses de l’important chantier que fut celui du deuxième fort Saint-Jean de 1748.
Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.
Références:
¹ Jacques Castonguay, Les défis du fort Saint-Jean. L’invasion ratée des Américains en 1775, Les Éditions du Richelieu, Saint-Jean, 1975, p.25.
² Marilou Desnoyers, Regard sur 350 ans d’histoire. Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2016, p. 27.
³ Ibid., p.27.
⁴ Ibid.
⁵ Rachel Ferland, « Marie-Élisabeth Rocbert de la Morandière », SIEFAR, [en ligne],https://siefar.org/dictionnaire/fr/Marie%C3%89lisabeth_Rocbert_de_la_Morandi%C3%A8re, [Site consulté le 25 avril 2025].
⁶ Céline Dupré, « Marie-Élisabeth (Marie-Isabelle) Rocbert de la Morandière (Bégon de La Cour) », Dictionnaire biographique du Canada, [en ligne],
https://www.biographi.ca/fr/bio/rocbert_de_la_morandiere_marie_elisabeth_3F.html, [Site consulté le 25 avril 2025].
⁷ Isabel Landels, « La correspondance de Madame Bégon », Thèse de doctorat présentée à la Faculté des lettres de l’Université Laval, 1947, p. 16.
⁸ Donald J. Horton, « Claude-Michel Bégon de La Cour », Dictionnaire biographique du Canada, [enligne], https://www.biographi.ca/fr/bio/begon_de_la_cour_claude_michel_3F.html, [Site consulté le 25 avril 2025].
⁹ Op.cit., Landels, p.12.
¹⁰ Op.cit., Dupré.
¹¹ Op.cit., Landels, p. 18.
¹² Ibid., p.20
¹³ Ibid., p.25
¹⁴ Rapport de l’Archiviste de la province de Québec, 1934-1935, Québec: Louis-A. Proulx, Imprimeur de sa Majesté le Roi,1921-1960, p.15.
¹⁵ Ibid., p. 41.
¹⁶ Ibid.
Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.