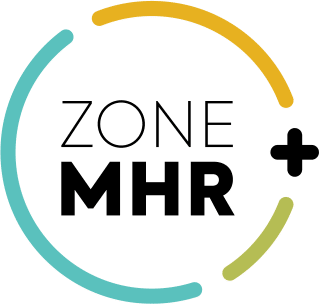Sur le Richelieu On the Richelieu River, Canada pittoresque, Saint-Jean & Sherbrooke : Pinsonneault Frères édit., [19–?], BAnQ., Domaine public.
La rivière Richelieu : un toponyme hérité du cardinal du même nom
L’histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu s’amarre véritablement au récit de sa rivière : le Richelieu. Ce cours d’eau revêtira plusieurs dénominations au fil du temps, vocables qui nous renseignent aujourd’hui sur les préoccupations de chacune des époques qui les a vues naître.
Pour Jacques Cartier, navigateur malouin et premier explorateur du golfe du Saint-Laurent en 1534, dont la mission était alors de « descouvrir certaines ysles et pays où l’on dit qu’il se doibt trouver grant quantité d’or et autres riches choses », elle sera l’intrigante rivière qui file vers le sud-ouest.¹
Aux dires des Autochtones qu’il questionne, ce mystérieux cours d’eau mènerait vers un territoire d’abondance où il n’y a jamais de glace ni de neige : la Floride. Cependant, Jacques Cartier n’empruntera pas cette rivière, il ne fera que la signaler dans ses relations de voyages.²
Magwaizibo
Comme mentionné dans une chronique précédente, la rivière Richelieu sera d’abord connue comme la Magwaizibo un terme abénaquis qui signifie « la rivière des Iroquois » ou encore la Masolientekw, soit « la rivière de beaucoup d’argent ».
Puis, au moment du passage de Samuel de Champlain en 1603, le dessinateur et géographe lui offrira le nom français de « Rivière des Iroquois ». Cette dénomination perdurera d’ailleurs jusqu’au milieu du XVIIIème siècle.
Cependant, c’est vers 1650 que notre rivière – véritable porte d’entrée sur le territoire de la Nouvelle-France – subira un changement toponymique qui s’avérera déterminant pour la suite de son histoire.
Richelieu
En août 1642, quelques mois après la fondation de Montréal, le gouverneur Charles Huault de Montmagny faisait s’ériger sur le territoire actuel de la ville de Sorel et à l’embouchure de cette importante voie d’invasion qu’empruntaient les Agniers (Mohawks), un fortin de bois qu’il baptisa Richelieu, en mémoire du cardinal du même nom.
On cherche alors à défendre l’accès à la colonie et à contrer la menace iroquoise qui assaille sans relâche les établissements français. C’est par la suite et de manière graduelle qu’une translation toponymique s’opérera du nom de la fortification édifiée sous l’impulsion de Montmagny vers celui de la rivière des Iroquois qui deviendra à son tour Richelieu.

John Henry Walker, Portrait du cardinal de Richelieu, encre sur papier monté sur papier, gravure sur bois, 6,2 cm x 5,2 cm., 1850-1885, Collection Musée McCord. Domaine public.
Rappelons que le cardinal de Richelieu, né Armand Jean du Plessis, fut le principal ministre du roi Louis XIII et qu’il mettra sur pied le 29 avril 1627 la Compagnie de la Nouvelle-France mieux connue comme celle des Cent-Associés. En plus de détenir le monopole de la traite des fourrures dans la jeune colonie, la Compagnie veillait également à son peuplement.
D’ailleurs, primitivement, le territoire qui accueillera la ville de Saint-Jean était compris dans la seigneurie de la Citière, un vaste fief créé en 1635 par la Compagnie des Cent-Associés et qui s’étendait alors de la rive-sud de Montréal, jusqu’à l’état de New York et même à dix lieues au-delà, en pleine mer³.
Carinan-Salières
Par la suite, Louis XIV roi de France imposera en 1663 le gouvernement royal en Nouvelle-France. Le territoire sera alors administré par Jean-Baptiste Colbert, ministre de la Marine en France et conseiller du roi ainsi que par Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France4. Avec cette nouvelle structure administrative, le roi tente de faire passer définitivement la Nouvelle-France de colonie-comptoir, à une colonie de peuplement.
En outre, on souhaite à ce moment accroître la défense de la colonie qui est plus que jamais exposée aux attaques des Iroquois qui s’opposent aux relations commerciales qu’entretiennent les Français avec leurs alliés autochtones. Cette lourde tâche sera confiée à Alexandre de Prouville de Tracy, lieutenant-général de l’armée du roi en Amérique ainsi qu’au gouverneur Daniel Rémy de Courcelles.
C’est donc pour pallier la menace iroquoise que Louis XIV ordonnera en 1664 le déploiement du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France. Ainsi, 1200 hommes, sous l’autorité du gouverneur de Courcelles débarqueront à Québec en 1665 et auront comme tâche première la fortification de la rivière des Iroquois, qu’on nomme à présent Richelieu.
Forts
Dès 1665, le régiment de Carignan-Salières dresse les trois premiers d’une série de cinq forts le long de la rivière Richelieu. Ces fortins de pieux rudimentaires servent à la fois de points de ravitaillement sécurisés et de réduits en cas de raids. En outre, en plus d’être essentielles à la défense du territoire contre les invasions iroquoises, ces fortifications offrent la possibilité de mener des assauts en pays agnier (mohawk).
De cette façon, s’élèveront successivement le fort Sorel sur les ruines de l’ancien fort Richelieu, le fort Saint-Louis que l’on connaît désormais sous le nom de Chambly et finalement le fort Sainte-Thérèse situé face à la pointe actuelle de l’île Sainte-Marie.
Notons qu’il était commun de voir à l’époque les fortifications changer de dénomination. De cette manière, les forts Richelieu et Saint-Louis hériteront des noms des capitaines du régiment de Carignan-Salières responsables de leur édification.
Ainsi, le fort Richelieu deviendra Sorel en l’honneur de Pierre de Saurel qui aura la tâche de reconstruire la fortification de 1642 située à l’embouchure du Richelieu. Puis, le fort Saint-Louis élevé au pied des rapides durant la troisième semaine d’août – moment où le calendrier liturgique signale la fête de ce roi de France canonisé – deviendra Chambly en référence à Jacques de Chambly.
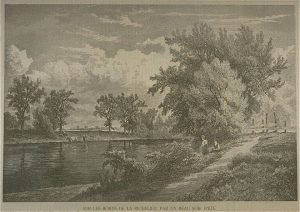
Sur les bords du Richelieu, par un beau soir d’été, Illustration tirée de Album universel, Vol. 19, no 17 (23 août 1902), p. 406., BAnQ. Domaine public.
Ces changements de vocables influeront aussi sur la rivière Richelieu, qui sera durant quelque temps désignée (parfois dans son ensemble, mais aussi pour pointer certains de ses tronçons) comme la « rivière Sorel », puis la « rivière Saint-Louis » et enfin la « rivière Chambly », au moment où la colonisation débute à cet endroit.⁵
Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.
Références:
¹ Lionel Groulx, La découverte du Canada, Jacques Cartier, Montréal, Librairie Granger frères, limitée, 1934, 290 p.
² Relations, Jacques Cartier, édition critique par Michel Bideaux, Presses de l’Université de Montréal, coll. Bibliothèque du Nouveau Monde, 1986, p.168
³ Claude Boudreau, Serge Courville et Normand Séguin (dir.), Atlas historique du Québec, Territoire, Collection Atlas historique du Québec, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1997, p.32
⁴ Samuel Venière, « Jean-Baptiste Colbert », L’encyclopédie canadienne, [en ligne], https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-baptiste-colbert, [Site consulté le 1er mars 2025]
⁵ Commission de toponymie du Québec, Noms et lieux du Québec : dictionnaire illustré, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1994, p .574
Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.