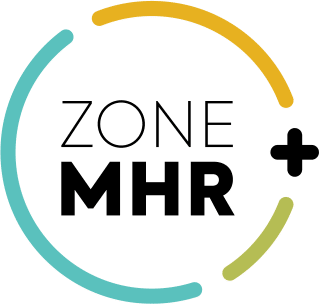Une ancienne auberge située à la croisée des chemins
La demeure sise au 525, chemin du Grand-Pré dans le secteur L’Acadie (Saint-Jean-sur-Richelieu) aurait été construite au tournant du 19e siècle. Au cours de son histoire, elle connaîtra plusieurs vocations. Ainsi, en plus d’accueillir un relais pour chevaux, elle servira également de magasin général¹ et d’auberge² .
Au recensement de 1831, on dénombre d’ailleurs jusqu’à six auberges à l’est de la petite rivière de Montréal (ancienne appellation de la rivière L’Acadie).

Rue principale à L’Acadie (aujourd’hui le Chemin des Vieux-Moulins), vers 1920, Collection Musée du Haut-Richelieu.
Il faut dire qu’à l’époque plusieurs voyageurs passent par cette localité notamment pour se rendre aux États-Unis.
Les auberges apporteront toutefois leur lot de problèmes à L’Acadie. En 1856, on limitera d’ailleurs leur nombre à deux et on précisera même que leur licence ne sera valide que pour une année.³ C’est qu’en 1853, l’abbé Rémi Robert, alors curé de la paroisse Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (L’Acadie), se plaignait à son évêque que ses gens s’enivraient dans une auberge du village tenu par un ivrogne et qu’ils y jouaient même à l’argent.⁴
Mgr Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, décréta alors qu’en raison de ces débordements à l’auberge, il n’y aurait pas de messe de minuit à L’Acadie cette année! Dans son Histoire de L’Acadie (1908), l’abbé Stanislas-Albert Moreau raconte, en se référant à la missive envoyée par le curé Robert à son supérieur, que cette sanction sera pour les paroissiens de L’Acadie un véritable « coup de foudre ».⁵
Patriotes
Dès les années 1835-1836, la maison du 525, chemin du Grand-Pré, sera louée par l’aubergiste Joseph Alexandre Sabatté (1786-1840)6. Natif de Chambly⁷, Sabatté cumulait différents emplois dans la paroisse Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Longtemps maître d’école au presbytère, là où il enseignait aux garçons, il était aussi crieur public et huissier⁸. On le disait en outre marchand, épicier et imprimeur⁹.
À cette même époque, l’auberge Sabatté sera l’hôte de Patriotes. Ainsi, le docteur Cyrille-Hector-Octave Côté (1809-1850), véritable figure de proue du mouvement patriote¹⁰, y aurait tenu des réunions¹¹.
Le 21 décembre 1837, Joseph Alexandre Sabatté, après avoir prêté serment sur les saints évangiles, fera d’ailleurs une déposition dans laquelle il dénonce une compagnie formée à L’Acadie sous la direction de Guillaume Benziger, un instituteur qui enseigne dans la paroisse au rang de Belle-Corne. L’aubergiste qui disposait alors d’informations privilégiées, soupçonne ces Patriotes de s’exercer à l’art militaire.¹²
Architecture

Photographie tirée de l’ouvrage Pierre Brault, Histoire de L’Acadie du Haut-Richelieu, Éditions Mille Roches, 1982, p.165.
Notons par ailleurs que cette demeure possède une charpente dite en croix de Saint-André, équarrie à la hache¹³. La croix de Saint-André est un contreventement (assemblage de pièces) en forme de « X », qui sert à stabiliser une charpente¹⁴. On la nomme ainsi, car une telle croix aurait été utilisée afin de supplicier saint André.
Remarquez aussi les souches de cheminées faites de moellon et disposées « en chicane ». Cette drôle d’expression est utilisée pour discuter de cheminées qui se retrouvent chacune placées sur leur propre versant d’un toit, comme si elles ne souhaitaient pas être réunies.
Dans d’autres cas, on ajoutera une fausse souche de cheminée à une maison, par soucis d’équilibre. Pour désigner ce postiche, on parlera plutôt d’une cheminée « menteuse », car cette dernière n’est pas tout à fait ce qu’elle prétend.
Il est intéressant de relever ces expressions anthropomorphiques qui servent à décrire notre architecture. Nos ancêtres aimaient vraisemblablement attribuer aux objets des intentions humaines. À cet effet, l’ethnohistorien Michel Lessard indique que les artisans ont souvent utilisé les parties du corps humain pour désigner l’objet de leur travail.¹⁵

Famille Bélanger, 1916. Collection Odile Déplanche.
Asymétrie
Ici, la disposition des fenêtres et des portes vient répondre à des besoins fonctionnels, plutôt qu’à une esthétique classique guidée par un souci d’équilibre. Ces ouvertures distribuées de manière asymétrique, font d’ailleurs le charme de cette maison traditionnelle québécoise.
Fait intéressant, les façades est et ouest de cette propriété sont identiques. On imagine qu’à une certaine époque, la façade principale était orientée vers le chemin qui passait du côté est.
Suite à la disparition de cette route, on a probablement privilégié la façade ouest, où le carré principal fut jadis percé par deux portes. De nos jours, on comprendra que la quantité ahurissante de camions lourds qui circulent à la croisée des chemins, force un repli du côté est. Là, une superbe cour intérieure nous fait presqu’oublier l’omniprésente pollution sonore, véritable fléau qui sévit au cœur du village historique de L’Acadie.
Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.
Références:
¹ Elle aurait entre autres abrité les commerces de Pierre-Louis Girardin en 1816, de Hilaire Roy en 1845, d’Alcide Deland en 1911 et de Joseph-Albert Desranleau en 1935. Voir Nicole Martin-Verenka, L’Acadie du Haut-Richelieu : 1762-2001, Montréal, Histoire-Québec, Collection de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine, 2006, p.337.
² Ibid.
³ Pierre Brault, Histoire de L’Acadie du Haut-Richelieu, Éditions Mille Roches, 1982, p. 138.
⁴ Archive du diocèse Saint-Jean-de-Longueuil, Paroisse Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, 11A/163, M. Robert à Mgr Bourget, 6 décembre 1853.
⁵ Ibid., 11A/164, M. Robert à Mgr Bourget, 18 décembre 1853.
⁶ Op.cit., Martin-Verenka, 2006, p.210.
⁷ Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal (PRDH), JosephAlexandre Sabatté, Baptême à Chambly (Saint-Joseph), le 27 mars 1786 et sépulture à Sainte-Margueritede-Blairfindie (L’Acadie, le 11 mai 1840, Fiche no 692022.
⁸ Stanislas-Albert Moreau, Histoire de L’Acadie, province de Québec, Montréal, s.é., 1908, p. 87.
⁹ La Minerve, Montréal, vol. 1, no 61, édition du jeudi 13 septembre 1827 et La Minerve, Montréal, vol. 7, no 65, édition du jeudi 26 septembre 1833
¹⁰ Richard Chabot, Dictionnaire biographique du Canada, [en ligne],
https://www.biographi.ca/fr/bio/cote_cyrille_hector_octave_7F.html, [Site consulté le 20 novembre 2024].
¹¹ À l’été 1832, au moment où sévit l’épidémie de choléra, le docteur Côté viendra en effet se fixer à Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (L’Acadie). Le médecin de descendance acadienne qui sera élu député de la circonscription de L’Acadie en 1834, siègera à la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada jusqu’en 1838.
¹² Déposition de Joseph-Alexandre Sabatté, aubergiste de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, 21 décembre 1837, Événements 1837-1838, E17,S37,D74 , BAnQ Québec.
¹³ https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8890575/croix-de-saint-andre
¹⁴ Michel Lessard et Gilles Vilandré, La maison traditionnelle au Québec, Éditions de L’Homme, 1974, p.213.
¹⁵ Michel Lessard, « Le retour du four à pain traditionnel », dans Continuité, numéro 164, printemps 2020, p. 14.
Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le Gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.